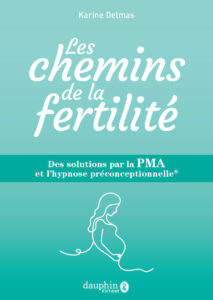Entretien avec Philippe ROUSSEL
Cofondateur et vice-président de l’association Les Cigognes de l’Espoir
Pouvez-vous nous présenter Les cigognes de l’espoir ?
L’association Les Cigognes de l’Espoir a pour objet d’apporter son aide aux personnes infertiles ou qui ont des difficultés à avoir des enfants. C’est une très grosse association de plus de 3 000 adhérents et en comptant les personnes qui gravitent autour (inscrits sur le forum), nous comptabilisons environ 8 000 personnes. Nous aidons tout le monde même ceux qui ne sont pas adhérents. En revanche, seuls les adhérents bénéficient des réductions proposées par certaines cliniques, comme des réductions chez les thérapeutes partenaires de l’association.
Que proposez-vous dans le cadre de l’association ?
– Information notamment sur le don d’ovocytes et la PMA en général
– Formations, webinaires, réunions, conférences
– Conseils en médecines douces
– Conseil concernant les cliniques
– Soutien moral (permanence téléphonique)
– Aide par rapport à la sécurité sociale
– Colloques, livres, pièce de théâtre…
Qu’est-ce qui vous a poussé à créer l’association Les cigognes de l’Espoir ?
Nous avons créé l’association il y a quatorze ans, suite aux difficultés personnelles que mon épouse et moi avons rencontrées dans le cadre de la PMA en France. Un parcours très long, avec des rendez-vous très espacés, dans lequel l’aspect psychologique était complètement absent et avec une efficacité relativement faible, même au niveau médical. À la fin, ma femme allait avoir 43 ans donc c’était la limite. Ils lui ont dit « de toute façon, vous ne pourrez jamais avoir d’enfant, mais éventuellement, vous pouvez réfléchir au don d’ovocytes », ce dont on ne nous avait jamais parlé avant. On ne savait pas ce que c’était. On a cherché sur Internet. Mon métier c’est d’être voyagiste, donc je voyage forcément beaucoup, alors on a cherché où il pourrait y avoir des possibilités à l’étranger car en France c’était déjà compliqué.
On avait d’abord, comme tout le monde, consulté les Espagnols et on a vite renoncé pour de multiples raisons, notamment parce que c’est presque de la vente forcée chez eux. Ce sont des « boîtes à fric ». Et puis j’ai découvert que la République Tchèque, qui parlait assez peu de ses capacités en PMA, avait presque cinquante cliniques spécialisées, ce qui est énorme pour un petit pays. On a pris contact avec plusieurs cliniques, l’une d’elles a répondu dans un français approximatif, alors on est allés voir et on est tombés sur une clinique très moderne, on ne s’attendait pas à ça du tout : très grande, gens très attentionnés, ultramoderne. En dehors de la langue c’était mieux que ce qu’on avait dans les services de PMA en France. On s’est dit « On va tenter », et ça a marché du premier coup !
Quels sont les profils et âges des personnes que vous rencontrez dans le cadre de l’association ?
Le profil des personnes que soutient l’association a changé depuis nouvelle la loi Bioéthique : avant 2021 cela concernait essentiellement des couples hétérosexuels entre 40 ans et 49 ans. Depuis 2021, il y a toujours ceux-là et maintenant il y a les femmes seules et les couples de femmes qui ont des problèmes de délais d’attente + celles qui sont en attente de don car problème de fertilité + celles qui veulent bénéficier d’un traitement ROPA, qui est interdit en France (on utilise, dans le cadre d’un couple de femmes, les ovocytes de l’une pour implanter l’embryon chez l’autre).
Aujourd’hui 20 à 25 % des demandes concernent des couples de femmes et des femmes seules. Nous constatons une explosion de demandes chez les femmes seules, en particulier. Avant, les femmes étaient plus âgées, aujourd’hui il y a tous les âges et de plus en plus de femmes entre 25 et 30 ans qui veulent un enfant pour elles-mêmes (avant on n’en voyait pas). Même les couples de femmes sont plus jeunes (entre 30 et 35 ans).
Quels sont les pays que vous conseillez dans le cadre du don d’ovocytes et quelles sont les différences ?
Nous conseillons la République Tchèque mais elle ne pratique la PMA que pour les couples hétérosexuels. Pour les femmes seules et les couples de femmes, nous conseillons le Portugal, qui a été précurseur en la matière. La technique ROPA est autorisée dans de nombreux pays pratiquant la PMA, en Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Belgique (mais la Belgique n’a pas des résultats exceptionnels).
En Grande Bretagne tout est possible mais les tarifs sont rédhibitoires (25 000 euros en moyenne, comme aux États-Unis). Des pays tels que le Danemark, Lettonie, Lituanie, Estonie, mais c’est souvent plus compliqué au niveau de la langue et de la logistique (transports…).
Quelles sont les différences entre la France et l’étranger en matière de don d’ovocytes ?
La première c’est qu’en France, on n’a pas de donneuses ! Et quand on en trouve une, quel que soit son profil, on n’est pas trop difficiles ! Dans les autres pays elles ont entre 18 et 22 ans, en France elles en ont 32, 33… Ce n’est plus la même chose pour la fertilité.
Ensuite, en France, on partage les ovocytes pour la même raison (nombre trop faible de donneuses) : on prélève entre 10 et 12 ovocytes en général, sur une donneuse. Ces ovocytes sont classés par les embryologistes, selon leurs « capacités » à pouvoir être fécondés, leur qualité en quelque sorte (de A à D ou E). Quand on récupère 12, il est bien évident que les 12 ne sont pas en catégorie A (on en a généralement deux en catégorie A et ensuite ça diminue). Ces ovocytes seront répartis entre les receveuses (deux en moyenne par receveuse) et évidemment, celles qui ont les catégories A ça peut marcher, les autres, ça ne marche pas.
Et ensuite, il y a des problèmes de matériel, en France. Ça commence à changer, mais toutes les cliniques étrangères possèdent un système de timelapse (embryoscope par exemple) qui permet de faire un monitoring des embryons mis en culture, 24h/24 et de voir l’évolution des embryons sur grand écran. Cela permet de choisir les embryons les plus « aptes » à se développer et à donner un embryon viable. N’importe quelle petite clinique à l’étranger en a un ou deux, alors qu’en France, il y a encore 5 ans, quand un CHU en avait, c’était dans les journaux ! Le poste clef dans une clinique c’est l’embryologiste, car c’est lui qui va choisir l’embryon à implanter, ce qui est évidemment favorisé par ce type de matériel.
Donc la différence de réussites de dons d’ovocytes entre la France et les cliniques européennes, va de 20 à 70 %. Le taux de réussite des cliniques avec lesquelles on collabore dans le cadre de l’association se situe entre 70 et 82 %.
Les différences se voient aussi dans le temps passé. Les consultations à l’étranger sont plus longues, les médecins posent plus de questions car ils ont plus de temps. En France, même si les médecins sont très bons, ils sont débordés par le nombre de demandes et il y a en moyenne un an de délai pour avoir un rendez-vous. Ils n’y sont pour rien, ils font ce qu’ils peuvent. C’est d’ailleurs pour ça que souvent ils finissent par renvoyer certaines personnes vers l’association pour se tourner vers l’étranger. Le CHU de Nice notamment, nous envoie beaucoup de monde, car ils savent qu’ils ne pourront pas traiter certaines demandes dans un délai raisonnable. Dans certains CHU en France, le délai peut avoisiner les 5 ans pour un don d’ovocytes ! Et si vous avez un type ethnique non caucasien, la plupart du temps, il y a zéro donneur.
Pour quelles raisons manque-t-on tellement de donneuses en France ?
Parfois, les campagnes de prévention ne sont pas suffisamment efficaces et puis les donneuses ne reçoivent, en France, aucun dédommagement malgré le temps passé. Il y a quand même une anesthésie, un traitement tous les jours… elles ne reçoivent rien, donc ça n’incite pas vraiment à aller donner. À l’étranger, un dédommagement est fixé par l’État, qui varie selon les pays mais qui tourne en moyenne autour de 800 € (qui correspondent à la compensation du temps perdu pour le travail, les déplacements, etc.). Souvent c’est limité à trois fois dans sa vie. Les gens ne le font pas pour l’argent, mais au moins ils n’en perdent pas.
Concernant le don de sperme, le nombre de dons a baissé en raison de l’accès aux origines aux 18 ans de l’enfant. Les gens ont peur de donner, de peur de voir des enfants arriver chez eux à leur majorité, ce qui est un fantasme totalement fou car tout est parfaitement réglementé, il n’y a aucune filiation, tout est clair au niveau de la loi, mais dans l’imaginaire des gens c’est un peu ça.
Que pensez-vous de l’accès aux origines rendu possible par la loi ?
Nous sommes pour, dans l’association, car il y a trop d’enfants qui se posent des questions en étant nés de dons de gamètes. Au Portugal ils étaient très en avance là-dessus alors que c’était un pays anciennement très catholique et ça fonctionne très bien. C’est un plus. Mais ils n’avaient pas le choix car ils savaient très bien qu’avec les techniques d’ADN, dans quelques années il serait extrêmement facile de retrouver n’importe qui.
Les gens évoquent leur désir d’enfant mais presque personne n’aborde la question de l’enfant, qu’observez-vous par rapport à ça ?
À travers les centaines de conversations téléphoniques que j’ai depuis la création de l’association, je constate que personne ne s’intéresse à l’enfant.
Est-ce que les personnes que vous accompagnez expliquent à leur enfant qu’il est issu d’un don ?
Il y a dix ans les gens avaient tendance à dissimuler le don à leur enfant, il y avait beaucoup de tabous. Aujourd’hui la majorité des gens sont décidés à en parler à leur enfant mais il faut faire une différence au niveau culturel, notamment au niveau des populations et de la religion. Les personnes musulmanes ou d’origine africaine vont plutôt dissimuler. Les catholiques et personnes de type caucasien vont avoir tendance expliquer.
La religion joue un rôle important. La virilité de l’homme, l’incapacité à mettre sa femme enceinte est taboue même quand l’infertilité vient de sa femme. Cela revient à l’idée que « ce sont les ovocytes d’une autre femme, c’est comme si je la trompais ». D’ailleurs dans tous les pays musulmans, le don d’ovocytes est interdit. Les gens viennent chez nous sous un pseudonyme.
Qu’en est-il des FIV classiques ?
Pour une FIV sans don d’ovocytes, avec les gamètes d’un couple, les délais sont nécessairement beaucoup moins longs car le problème du don ne se pose pas. Et plus on va dans des établissements privés avec des dépassements, plus les délais se raccourcissent. Concernant les résultats, il y a moins de différence en termes de réussite qu’avec le don, on se rapproche, en France, des standards européens. C’est un peu moins bon en raison du manque de matériel et de temps, mais la différence est bien moins marquée que pour le don d’ovocytes (autour de 40 % de réussite pour les FIV classiques car ce sont des gens plus jeunes).
Quel a été le parcours des gens qui arrivent dans votre association ?
La plupart du temps, ils ont été jusqu’à la FIV et on a fini par leur dire qu’ils sont trop vieux, ou bien il n’y a pas de disponibilités pour un traitement par don de gamètes.
Que pouvez-vous nous dire concernant la préservation d’ovocytes ?
Pour la préservation d’ovocytes France, les délais sont très longs. Il y a quand même un côté « miroir aux alouettes ». Si vous le faites à 25 ans, le résultat ne sera peut-être pas trop mauvais, mais plus vous avancez en âge, plus les résultats ne sont pas bons. Parce qu’il faut avoir entre 13 et 14 ovocytes de catégorie A pour avoir une chance importante. Mais pour cela, il faut faire plusieurs ponctions car on ne récupère que 2 ou 3 ovocytes de catégorie A part ponction, alors il faut faire plusieurs fois cette stimulation, c’est contraignant.
Les femmes qui nous contactent pour faire cela à l’étranger ont entre 35 et 40 ans. Les cliniques sérieuses refusent ou leur expliquent qu’elles vont devoir 4, 5, 6 fois pour réussir à avoir suffisamment d’ovocytes de catégorie A.
Avec le don ça peut marcher à n’importe quel âge, heureusement les pays européens ont commencé à mettre des limites autour de l’âge. En France c’est 43 ans, un des plus bas. Ailleurs en Europe c’est 48 ou 49 ans en moyenne. Il n’y a que la Grèce qui est passée cette année à 53 ans, parce qu’ils ont besoin de sous, entre autres ! Moi je pense qu’il ne faut pas aller plus loin que les 48, 49 ans, ça me semble être la limite. En Inde, à Chypre Nord, tout est possible et tout est une question de prix. Certains pays se fichent complètement de l’éthique. À Chypre nord, enclave musulmane, il y a des dizaines cliniques et vous pouvez choisir ce que vous voulez, y compris avec une enveloppe, le sexe de l’enfant.
Que pensez-vous du test DPI-A interdit en France, et de la matrice Lab ?
Je suis favorable car ça éviterait beaucoup de fausses couches, et ça éviterait un certain nombre de naissances avec des anomalies génétiques, ce serait très utile. À l’étranger, c’est souvent librement possible mais ils ne le proposent pas systématiquement, seulement quand il y en a besoin. Concernant le matrice Lab, certaines cliniques étrangères le demandent souvent, d’autres disent que ça ne sert à rien. À 1 % près ce sont les mêmes taux de réussite avec et sans. Utile ou pas utile ? La communauté scientifique est partagée.
L’infertilité, est-ce un problème de société ?
3,3 millions de personnes concernées en France par l’infertilité. Il y a un défaut d’information des jeunes. Personne ne leur dit que la fertilité baisse à partir de 35 ans. Personne ne fait cette prévention dans les collèges et les lycées. Les jeunes pensent qu’il n’y a pas de souci, même à 40 ans.
Quel est le coût moyen d’un don d’ovocytes à l’étranger :
Entre 7000 et 8000 en moyenne, en Espagne, entre 12 et 15 000. Il faut un maximum de rentabilité (303 cliniques spécialisées en Espagne dont beaucoup appartiennent à des fonds de pension). Dans le cadre de notre partenariat pour nos adhérents, cela tourne entre 6000 et 7000 euros environ.
Qu’observez-vous chez les personnes qui contactent Les cigognes de l’espoir ?
Souvent les gens qui arrivent sont en mauvais état psychologique, ils ont l’impression de ne pas avoir été écoutés ni pris au sérieux par les équipes médicales. L’idée est d’être une machine qu’on répare, on ne tient pas compte du côté psychologique, il n’y a pas de suivi ou de soutien. Ça commence à changer, de plus en plus de centres embauchent des psys, mais jusqu’à présent ce n’était pas le cas, c’était purement clinique.
Et puis ils sont perdus, avec le sentiment de ne pas pouvoir en parler autour d’eux. C’est encore un sujet un peu tabou donc ils sont un peu seuls. Souvent, ils voient l’âge avancer, une sorte de couperet qui va tomber. Ce sont des gens très anxieux parce que ça ne fonctionne pas, le temps passe et parce qu’il faudra peut-être aller à l’étranger. Il y a des gens qui n’ont jamais voyagé, il va falloir trouver de l’argent… il y a mille raisons.
On est là pour les aider et leur expliquer qu’il y a des solutions.
Concernant le relationnel médecin-patient, qu’observez-vous ?
Les médecins devraient travailler sur le côté relationnel. J’entends très souvent les gens me dire que leur médecin a manqué de psychologie. En gros « on n’a plus l’âge, il nous a jetés ». La prise en charge psychologique est très insuffisante en France. À l’étranger, je ne vois pas de différence, notamment en raison de la langue. Mais ils auront des gens bienveillants et gentils dans les cliniques (infirmières, médecins, coordinatrice) mais il n’y aura pas d’accompagnement psychologique dans les cliniques. En France, cela est aussi lié au manque de temps. Peut-être que les jeunes médecins et spécialistes sont plus attentifs au côté relationnel.
Avez-vous l’impression que l’aspect psychologique est souvent pris en compte par les personnes confrontées à l’infertilité ?
La plupart des gens sont ouverts, ils sentent bien qu’il y a quelque chose, psychologiquement. Ils y ont réfléchi avant. On leur conseille de consulter un thérapeute, un ostéopathe, un hypnothérapeute, mais je ne sais pas combien font réellement la démarche. Ils vont facilement chez l’ostéo et certains hypnothérapeutes.
Quelles sont, d’après vous, les pistes d’amélioration qui pourraient être envisagées pour mieux accompagner ou soutenir les personnes en parcours d’AMP ?
Il faudrait une amélioration médicale, comme l’autorisation du DPI en France qui pourrait éviter pas mal de soucis. Il faudrait ouvrir au privé le don de gamètes pour éviter les années d’attente. L’infertilité n’est pas considérée comme une priorité médicale, malgré le rapport de 2022 qui dit que 3,3 millions sont concernées. Le plan Macron est de la poudre aux yeux. Proposer une consultation de fertilité autour de 25 ans ne va pas pousser les gens à faire un enfant pour autant. Il faut faire de la prévention avant, au niveau des collèges, des lycées, et ouvrir plus de consultations de fertilité, plus de centres de fertilité.
Une partie des gens sont en infertilité sociétale quand ils se remettent en couple ou décident de faire un enfant au-delà de 40 ans, tout comme les couples de femmes et les femmes seules, mais ce n’est pas une raison pour ne pas en tenir compte. Il faudrait développer le don de gamètes en France.
Le suivi psychologique est une évidence. Il y a un rdv dans le cadre du don avec un psychologue mais ce n’est pas un suivi psychologique. Les suivis se font dans le privé et ne sont pas remboursés, cela vient s’ajouter aux dépassements d’honoraires que prennent certains gynécos. La mutuelle prend de moins en moins en charge les dépassements.
Quelles sont les conséquences pour les enfants issus de dons ?
Il n’y a pas tant de conséquences que ça, si l’enfant a été informé. Au-delà d’un certain âge, ils veulent avoir une information sur l’origine des gamètes. Beaucoup recherchent leurs origines pour combler une espèce de vide. Par contre, pour ceux à qui on ne dit rien et qui le découvrent longtemps après, là c’est plus compliqué. Ils ont souvent eu l’impression qu’il y avait un secret de famille. Et il y a ceux qui ne le sauront jamais car c’est culturel : silence et black-out complet, aucune information ne filtre.
Auriez-vous des conseils à donner à des personnes qui démarrent leur parcours ?
Gardez espoir. Beaucoup sont déjà découragés dès le départ, notamment parce que les médecins ne sont pas très encourageants en disant : « insémination, le taux de résultat est entre 5 et 7 %, la FIV, ça va être 20 %, et le don il faudra attendre 4 ou 5 ans si on vous trouve une donneuse, et ce sera 25 % ». Ce sont de vrais chiffres mais c’est un peu décourageant. Et aussi de se faire suivre psychologiquement car il y en a plein ne s’en remettent qu’au médecin et ça a un côté un peu mécanique. Certains sont parfois dans une détresse psychologique et ont besoin d’être suivis. Il y a plein de solutions : psychologues, psychiatres en fonction de ce qui leur convient le mieux. Les associations écoutent mais ne peuvent pas aider plus que ça, il faut parfois des professionnels. Il faut aussi se méfier des faux professionnels. On est contactés sans arrêt par des soi-disant coachs en fertilité, parfois leurs propositions sont incongrues, c’est parfois très limite.
Quel genre de dérives observez-vous autour de la problématique d’infertilité ?
On peut acheter du sperme auprès de cliniques de qualité, par exemple au Danemark. Théoriquement ils n’ont pas le droit de vendre en France mais c’est expédié par la poste. Les dérives comme faire appel à un donneur via les réseaux sociaux (dans l’association, nous rencontrons 4 ou 5 personnes par an qui font cela) montrent à quel point les gens peuvent être désespérés. Dans certains cas, ça devient obsessionnel, ça relève parfois de la psychiatrie. On essaie de les réorienter vers le médecin. Il y en a même qui utilisent Tinder pour ça…
Que conseilleriez-vous à une personne dont l’AMP n’a pas fonctionné ?
Dans 30 % des cas rien ne va fonctionner, là il faut presque faire le deuil de l’enfant car se tourner vers l’adoption n’est pas la solution. Il n’y a presque plus d’enfant à adopter. De nombreux pays étrangers ont fermé les adoptions en France, depuis le mariage pour tous. Et en France, il y a surtout des enfants français, déjà grands ou porteurs de handicaps, mais les gens veulent un bébé. Et puis les parcours sont extrêmement longs. C’est difficile de donner un conseil mais il faut être au moins allé jusqu’au bout de la démarche. Certains sont allés au bout, jusqu’à 10 ou 12 tentatives parfois (ce qui est énorme) et à la fin, se sont tournés vers la GPA. Avant ils allaient en Ukraine, maintenant ils vont aux Etats-Unis, ce qui coûte 30 000 à 50 000 euros.
Philippe ROUSSEL

Après un parcours de PMA infructueux de plus de 10 ans en France, Philippe Roussel et sa compagne Anne Abrard ont eu une petite fille par don d’ovocytes en République Tchéque. Ayant reçu beaucoup de demande d’informations et de conseils lorsqu’Anne Abrard a voulu crier sa joie d’être enceinte sur les réseaux sociaux, et désireux d’aider un maximum de personnes en situation d’infertilité comme ils auraient aimé l’être pendant leur parcours, ils ont décidé de créer l’association Les Cigognes de l’Espoir.
Créée en 2011, l’association est devenue une référence pour les personnes ayant des difficultés à devenir parents.
Philippe ROUSSEL

Après un parcours de PMA infructueux de plus de 10 ans en France, Philippe Roussel et sa compagne Anne Abrard ont eu une petite fille par don d’ovocytes en République Tchéque. Ayant reçu beaucoup de demande d’informations et de conseils lorsqu’Anne Abrard a voulu crier sa joie d’être enceinte sur les réseaux sociaux, et désireux d’aider un maximum de personnes en situation d’infertilité comme ils auraient aimé l’être pendant leur parcours, ils ont décidé de créer l’association Les Cigognes de l’Espoir.
Créée en 2011, l’association est devenue une référence pour les personnes ayant des difficultés à devenir parents.